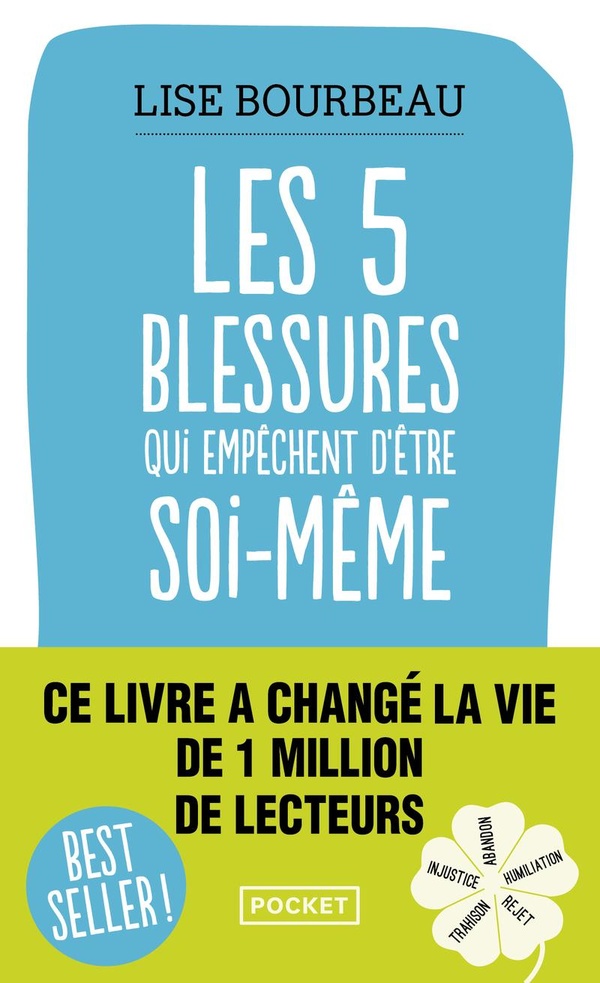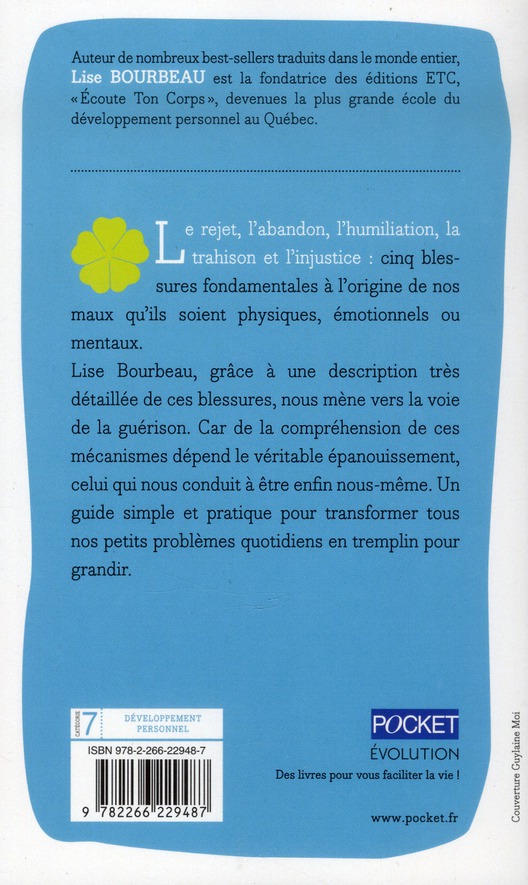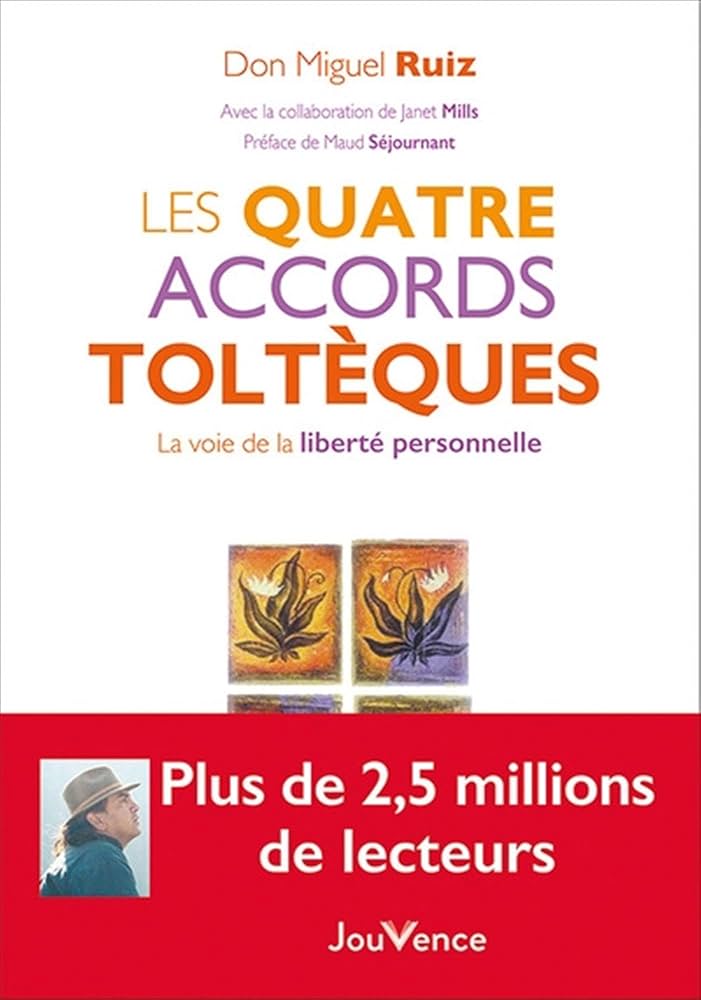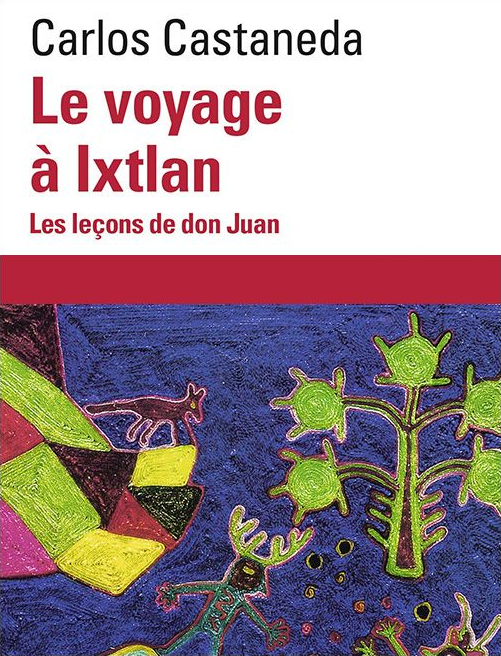Les nouveaux oligarques
Ils avancent masqués…
Dans leurs poches : les algorithmes, les lobbies, les capitaux mouvants.
Dans leurs discours : des slogans populistes, rutilants, empaquetés pour séduire.
Ce ne sont plus des rois, ni des dictateurs. Ce sont les nouveaux oligarques. Les figures fluides d’un ultralibéralisme sans visage, sans frontière, mais dont l’impact bouleverse nos vieilles institutions.
Ils ne conquièrent plus des terres, mais vos données, nos désirs, le temps d’attention. Ils ne font pas la guerre, ils font pire : ils achètent vos cerveaux.
Et pendant ce temps… nous scrollons sur les réseaux sociaux. Et manifestons par émoticônes interposés, dans ce flux de commentaires.
Nous savons que l’Histoire bégaie et se répète… Mais aujourd’hui, si le pouvoir change de masque sans changer de logique, nous sommes sur le point de vivre un revirement historique inédit. Un retour au totalitarisme (pour ne pas dire fascime) par le biais de l’ultra-technologie…
Alors une question se pose. Et si l’on refusait cette répétition ?
Au bord du basculement global
« La démocratie n’est jamais acquise. Chaque génération doit la préserver, la défendre et se battre pour elle. »
— Kamala Harris
Et si le fascisme du XXIe siècle n’avait plus besoin de bottes ni de coups d’État ? S’il se glissait dans les urnes, les algorithmes et les réseaux, mêlant populisme, ressentiment et stratégies de délégitimation des institutions ?
La démocratie est sous pression. La guerre, au sens propre, embrase des continents. La parole publique est dévoyée. L’extrême droite gouverne ou influence un nombre croissant de pays. Les réseaux sociaux ne sont plus des espaces de liberté mais de propagande, parfois à la demande des régimes les plus autoritaires.
Face à cette dérive, nous, citoyens et citoyennes, sommes placés devant un choix que l’on croyait réservé aux livres d’histoire : se taire, ou agir ?
« Dans toute société autoritaire, celui qui détient le pouvoir dicte. Et si vous essayez d’en sortir, il vous pourchassera. »
— Salman Rushdie
La fenêtre d’Overton
Trump, comme d’autres leaders populistes, maîtrise l’art de déplacer la « fenêtre d’Overton » : dire l’indéfendable jusqu’à ce que cela paraisse normal. Le chercheur Clément Viktorovitch le souligne: «ses discours ne visent pas à convaincre, mais à dérégler le débat public…», dans son analyse de la feuille de route du «Projet 2025» de Donald Trump. (cliquez sur les liens pour visionner les sources).
Répétition, simplification, réduction du monde à des figures ennemies. Dans cette stratégie, les institutions deviennent des obstacles, les journalistes des ennemis, les lois des faiblesses.
Il ne s’agit pas d’une exception. Cette tactique se retrouve désormais dans de nombreuses démocraties où le langage de la force remplace celui de la complexité.
« Aujourd’hui, une oligarchie se met en place en Amérique : une concentration extrême de richesse, de pouvoir et d’influence qui menace notre démocratie tout entière. »
— Joe Biden
Le pouvoir n’est plus uniquement politique. Il est économique, technologique, algorithmique. Elon Musk, en refusant à l’Ukraine l’accès au réseau Starlink pendant une opération militaire, a montré qu’un seul homme peut influer sur le cours d’une guerre.
Dans un autre registre, les plateformes sociales modifient ou censurent le contenu à la demande de gouvernements autoritaires. Sous Musk, X (ex-Twitter) a accédé à 83% des demandes étatiques de censure, y compris de régimes liberticides.
Ces « oligarques technologiques » ne sont pas élus. Ils n’ont pas de comptes à rendre. Et pourtant, ils orientent les flux d’information, les croyances, les débats et les campagnes électorales. Ils sont devenus les nouveaux rois sans visages.
« Nous ne vivons plus dans un régime démocratique. »
— Steven Levitsky
En 2024, 71% de la population mondiale vit sous un régime autoritaire ou hybride. En Europe, l’extrême droite gouverne ou participe à sept gouvernements. En Afrique, les coups d’État militaires se multiplient. En Amérique du Sud, l’extrême-libéralisme se pare de vêtements fascisants.
Et dans les démocraties dites consolidées, les contre-pouvoirs sont attaqués : juges neutralisés, presse décrédibilisée, lois liberticides adoptées par décret. La Hongrie, la Pologne, Israël, l’Italie, les États-Unis sous Trump… l’État de droit recule.
Mais ce recul se fait sans bruit. Il avance sous couvert d’élections, de légalité, de « sécurité ». Il avance parce que la majorité silencieuse préfère attendre.
« Les autoritaires ne peuvent prospérer que si les communautés sont faibles. Quand les gens agissent ensemble, avec joie, ils sont invincibles. »
— Heather Cox Richardson
Mais, ce n’est pas une fatalité. Partout, des voix s’élèvent. Des journalistes résistent. Des ONG poursuivent en justice. Des collectifs créent des plateformes de transparence. Des citoyens manifestent, lancent des alertes, construisent des outils de contre-pouvoir.
Que pouvons-nous faire à notre échelle?
- Soutenir une presse libre et rigoureuse
- Participer à la surveillance citoyenne du pouvoir
- S’engager dans des collectifs locaux ou internationaux
- Rejoindre des mobilisations non violentes
- Protéger les droits des plus vulnérables
- Mais surtout: s’entrainer au «Fact checking»
La démocratie ne disparaît pas en un jour. Mais si l’on y regarde de plus près, le pouvoir grandissant des nouveaux oligarques efface nos libertés citoyennes par petites touches, rongeant inéxorablement la démocratie de l’intérieur.
Le dilemme moral : Porte A ou Porte B ?
« L’intégrité, c’est me dire la vérité à moi-même. L’honnêteté, c’est dire la vérité aux autres. »
— Spencer Johnson
Dans la série Dogs of Berlin, un policier doit choisir : dire la vérité et perdre l’opportunité de gagner la guerre contre la pègre, ou mentir momentanément et pouvoir frapper le coup fatal, pour gagner définitivement et recevoir les honneurs et terminer en héros?
Cette question ne trouve pas de réponse figée et théorique. Elle se traverse, elle s’incarne. Elle exige une conscience aiguë du contexte. Et surtout nous pousse à un choix. Nous devons décider.
Alors, posez-vous cette question essentielle, celle qui dérange, qui nous crie sur fond d’embrasement du monde :
Si vous saviez que l’histoire allait se répéter…
Auriez-vous le courage d’agir différemment aujourd’hui?

Il n’y a pas de sauveur.
Pas de retour possible à la normale.
Pas plus de solution dans l’absolu.
Ce monde s’invente à chaque nouveaux pas, chaque refus, chaque choix. Il exige qu’on ouvre les yeux, qu’on sorte du confort numérisé, qu’on redevienne des auteurs et non de simples utilisateurs.
Car ceux qui rêvent à notre place fabriquent aussi nos pires cauchemars.
Décider. C’est peut-être la seule insurrection qui nous reste.
Ne pas choisir, c’est choisir par défaut.
Ne pas parler, c’est consentir.
Texte inspiré de faits réels, d’analyses croisées (Freedom House, Viktorovitch, Géopolitis), et de l’observation du monde en 2025.