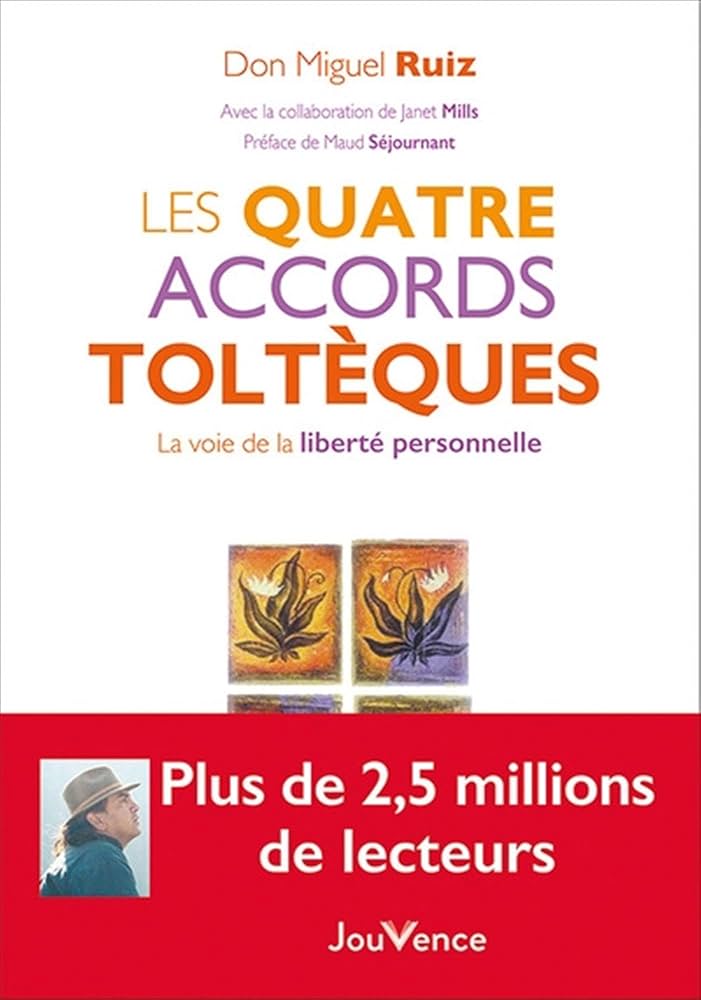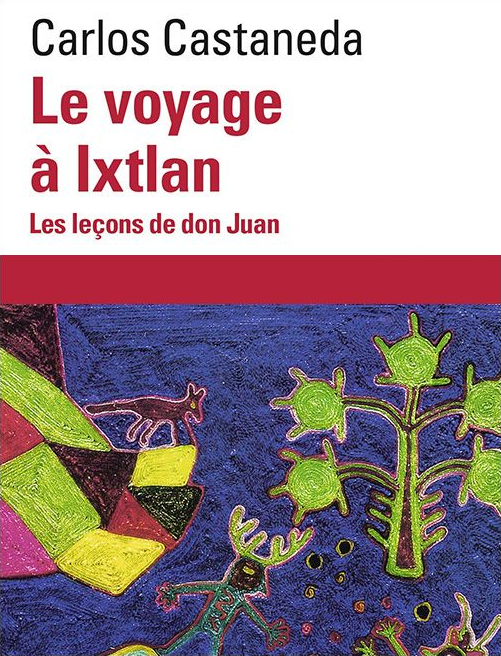Le Guide récalcitrant
Il y a quelques années, on m’a fait découvrir des livres qui proposait leur vision onirique sur une voie, enseignée par la sagesse ancestrale, pour devenir un Homme avec un grand H — pas juste un type qui se débat avec ses factures et ses doutes, mais quelqu’un de plus grand, plus sage. L’Homme Éveillé…
Dans Le Voyage à Ixtlan, Carlos Castaneda parle de quatre ennemis à confronter lors de notre passage sur terre : la peur qui me fige, la clarté qui me fait croire que j’ai tout compris, le pouvoir qui me monte à la tête, et la vieillesse qui me rappelle mes limites. Ces ennemis ne doivent pas être vaincu, mais domptés comme des animaux sauvages. Nous acquérons ainsi leur force et pouvons l’utiliser pour nous.
Puis, dans Les Quatre Accords Toltèques, Miguel Ruiz nous transmet quatre règles toutes simples : parler vrai, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions et toujours faire de mon mieux.
À lire, ça sonne bien, presque trop facile. Mais dans ma propre vie ? C’est une autre histoire… Je veux être cet Homme éveillé, vraiment.
Pourtant, je suis souvent récalcitrant. Un cheval mal débourré refusant l’obstacle. La peur me paralyse parfois quand je dois prendre une décision importante — changer de boulot, affronter un conflit. Je me dis : Et si je me plante ? La clarté, quand elle vient, me rend parfois arrogant ; je juge trop vite, oubliant de poser des questions. Le pouvoir ? Dès que j’ai un peu de contrôle, je peux devenir impatient, exigeant et tranchant. Et la vieillesse… à cinquante-neuf ans passés, je sens déjà mes genoux craquer, mes aspirations s’alourdissent, et je me demande si n’est pas trop tard.
Ces enseignements ancestraux, ils me parlent. Je veux les adopter, oui, mais comment les appliquer ? Tu m’expliques? Dire la vérité quand je suis en colère, ne pas prendre les critiques comme des coups, ou faire de mon mieux quand je suis crevé — c’est dur. Parfois, je n’y arrive pas. Je suis sur ce chemin, oui, mais je traîne souvent les pieds. Je résiste, freinant des quatre pieds…
Alors, pour mieux comprendre ces idées, je veux vous raconter une histoire. Celle d’un guide, en montagne, face à une tempête et un choix impossible. Parce que dans les cimes, ces concepts ne restent pas des mots : ils prennent vie, brutaux et implacables. Imaginons la scène.
La tempête
Le vent me gifle comme une main gelée, un hurlement qui s’infiltre jusque dans mes os et déchiquette mes pensées. Chaque inspiration me brûle les poumons, un feu glacé qui me coupe le souffle. Le brouillard est une muraille blanche, si épais que je ne vois plus mes pieds, juste mes crampons qui mordent la neige battue par la tempête.
À 4 000 mètres, nous sommes parti à l’assaut du Pic des Ombres. Je suis à bout, et derrière moi, la corde vibre, tendue à se rompre. Clara et Marc, mes clients, s’accrochent à ce fil, leurs vies entre mes mains. —Tiens bon, ne lâche pas—, je me répète, mais une voix sournoise murmure : —Et si tu n’y arrivais pas?— «Avancez !» je hurle, la gorge râpée par le froid. Je vois le courage de Clara qui plie sous l’effort —Je dois tenir— je le sens dans ses pas lourds. Marc traîne une peur qui cogne —Mes gosses…—, un écho que le vent me renvoie. «Clara, rythme! Marc, corde!» je crie encore, pour les secouer, pour me secouer moi-même et me donner du courage.
Et puis, ça craque. Un grondement sourd, un claquement guttural, et Clara chute!
Son cri me transperce —Nooon!—, sa terreur me heurte comme une lame. La corde me tire, mes crampons raclent, et je plante mon piolet, un réflexe qui hurle —Tiens bon—. Mes bras tremblent, mes pensées s’embrouillent : Je ne peux pas la perdre. Marc s’agrippe derrière, sa panique cogne mes pensées —Coupe, ou on crève—, et il hurle : «Clara! Tiens bon!» Mais la crevasse me tire vers elle, et la peur me serre les tripes. —Tranche, ou on meurt!— j’ai le souffle coupé. Une autre voix résonne dans ma tête, cristalline : «La peur est le premier ennemi. Apprivoise-la.» —Facile à dire—, je ricane intérieurement, mais mes doigts saisissent le couteau, et je me hais pour ça.
Clara pend dans le vide, un poids qui nous entraîne, et je sens son désespoir —Il va me tenir—, une prière muette. Marc halète, ses mots me frappent : «Fais quelque chose! Putain!» Le vent me broie, et je ne suis plus un guide, juste un homme qui titube sous l’effort. Ma lame touche la corde tendue à bloc, mes pensées s’entrechoquent —Couper, elle est perdue. Tenir, c’est tous nous condamner à mort—. Alors je ferme les yeux et je tranche d’un coup sec!
La corde claque, un vide s’ouvre en moi, et Clara s’efface sans un bruit dans le brouillard. Mon cœur s’arrête, pétrifié. Marc s’effondre près de moi, ses larmes chaudes s’évaporent dans le froid — Le vent hurle. Mais nous trouvons enfin une fissure nous fournit un abri de fortune, et on s’y écroule, vivants mais brisés. Je viens de tuer Clara — je suis stupéfait et dévasté par la culpabilité.
Mais trois jours plus tard, une silhouette se distingue au loin. Une forme plus sombre, qui rampe vers nous… Puis c’est l’exclamation au camp de base : «Clara! Clara! Elle est vivante!». Un miracle! — Nous croyons rêver…
Par chance, une corniche dans la crevasse a amorti sa chute, un hasard incroyable. Elle souffrait d’un fracture ouvrete à la jambe, Sa seule issue, se laisser glisser et toucher le fond. Là, à bout de force et totalement sans espoir elle était prête accepter son sort funeste. Mais une chanson qu’elle détestait particulièrement lui est venue en tête — Dancing Queen d’ABBA. Elle m’a avoué plus tard, avec un un rire amer : «Je me suis dit —Je peux pas crever sur du ABBA. C’est ridicule! Pas question!—».
Cette blague macabre, induite par son cerveau cherchant à survivre par tous les moyens, l’a totalement secouée. Elle s’est mise à ramper, vingt mètres à la fois, des étapes de dix minutes, rochers par rochers. les doigts gelés et le corps hurlant. Mais dans sa mémoire, la graine dont je lui avais parlé —celle qui perce la pierre— avait pris racine et s’est mise à la pousser en avant, centimètre après centimètre, jusqu’à trouver la lumière et l’air libre!.
Elle a transformé le froid en défi, la peur en carburant, et elle a atteint le camp. Un vrai miracle, en piteuse état mais vivante. Elle me fait face, souriante, ses yeux brillent d’une force que je n’ai pas. «J’ai tenu ma corde» elle murmure, tapotant sa tempe, «pas avec mes mains, mais là-dedans.»
Et moi, je reste là, devant elle, un guide récalcitrant qui a coupé la corde…
L’éveil
Cette nuit-là, dans ce drame, les enseignements de Ruiz et de Catsaneda se mettent en scène sous un jour extrême.
Clara a dompté sa peur, trouvé une clarté dans son désespoir, usé son pouvoir pour survivre, et défié ses limites physiques. Le Gudie? Il a coupé la corde. Il cédé à la peur, la clarté l’a poussé à juger, le pouvoir l’a fait choisir de sauver sa propre vie, son épuisement l’a persuadé qu’il n’avait plus la force de tenir. Il a fait de son mieux, comme les accords toltèques le suggèrent, mais son mieux était-il assez? La culpabilité l’a tenaillé pendant des années, même après avoir retrouvé Clara.
Je cherche à m’éveiller et devenir un homme, moi aussi, mais je suis récalcitrant comme ce guide : un homme qui trébuche.
Clara, avec son ABBA ridicule et la force qu’elle puise dans sa graine obstinée, a montré ce que je refuse encore d’admettre pleinement. Elle a survécu, pas par perfection, mais par une force brute et imparfaite.
Et ça me fait penser : peut-être que l’éveil, ce n’est pas devenir un sage irréprochable. Peut-être que c’est juste accepter ses failles, couper une corde quand il le faut, ou ramper vingt mètres parce qu’on refuse de mourir sur une chanson qu’on déteste.
Mais voilà… J’entends déjà tes questions… L’éthique, la morale — où est la ligne? Couper pour vivre, est-ce trahir ou sauver? Tenir jusqu’au bout, est-ce une preuve de courage ou un aveu de folie?
Et moi dans tout ça? Je la coupe cette corde? … ou vais-je trouver ma graine?
Je suis encore en chemin, un pas hésitant à la fois, récalcitrant mais curieux de voir jusqu’où ça me mène.
Librement inspiré d’une histoire vraie
Racontée dans le film «La mort suspendue»
Un film de Kevin Macdonald, avec Joe Simpson, Simon Yates.
Mai 1985, Cordillère des Andes, Pérou. Joe et Simon, deux alpinistes britanniques, tentent la face ouest du Siula Grande. Ils atteignent le sommet, mais c’est à la descente que se produit le drame. Dans la tempête, Joe tombe et se casse la jambe. À 6000 mètres, sur cette montagne isolée, Joe n’a aucune chance de s’en sortir. Et Simon sait que s’il essaie d’aider son ami, lui aussi est perdu ! Simon va devoir prendre la décision la plus terrible qui soit: couper la corde qui le relie à son ami Joe.
Bibliographie
Dans Les Quatre Accords Toltèques (1997), Don Miguel Ruiz s’inspire de la sagesse des anciens Toltèques pour proposer un code de conduite destiné à la liberté personnelle et à la paix intérieure.
Don Miguel Ruiz, né et élevé au Mexique par une mère curandera (guérisseuse) et un grand-père nagual (chaman), choisi de faire des études de médecine et de devenir chirurgien. Une rencontre avec la mort (NDE), au début des années 70, suivie d’une expérience extra-corporelle saisissante a changé sa vie. Il s’est dès lors consacré à la maîtrise de la sagesse ancestrale. Il est maintenant devenu un nagual de la lignée des Chevaliers de l’Aigle, voué au partage de sa connaissance des enseignements des anciens Toltèques.
Dans Voyage à Ixtlan (1972), Carlos Castaneda poursuit son apprentissage avec Don Juan Matus, un sorcier yaqui. Contrairement aux précédents ouvrages, ce livre abandonne l’usage des psychotropes pour se concentrer sur un enseignement plus profond : la transformation de la perception et l’abandon du monde ordinaire. Don Juan guide Castaneda à travers des pratiques comme «effacer son histoire personnelle», «vivre comme un chasseur» et «accepter la mort comme conseillère». Le but est de se libérer des illusions du monde et de marcher sur le chemin du guerrier, un être détaché, fluide et conscient de l’instant. Ixtlan, cité mythique, symbolise le retour impossible à un passé idéalisé.
Ce voyage initiatique n’est pas un déplacement physique, mais une métamorphose intérieure, un éveil à une réalité au-delà de l’ego et des conventions.
Pierre-Yves Gadina © 16 mars 2025